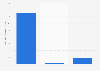Le don du sang en France - Faits et chiffres
Un besoin de mobilisation constant pour le don du sang
Souvent motivés par un sens aigu de la solidarité, environ 1,6 millions de personnes donnent leur sang chaque année en France. Cependant, un déséquilibre persiste et ce chiffre reste insuffisant pour répondre à la demande, c’est pourquoi la France se voit dans l’obligation d’importer grand nombre de préparations sanguines. D’après l’EFS, il faudrait collecter 10.000 poches de sang chaque jour pour soigner les patients, que ce soit pour des chirurgies, des traitements contre le cancer ou des soins d’urgences.Pour surmonter les pénuries, plusieurs stratégies ont été mises en place. Parmi elles, les campagnes de sensibilisation ainsi que les grandes collectes organisées dans des lieux publics par l’EFS jouent un rôle central. À cela s’ajoute la journée mondiale des donneurs de sang organisée chaque 14 juin par l’Organisation mondiale de la santé dans le but de sensibiliser les populations aux enjeux des dons et de souligner la contribution des volontaires. Ces initiatives visent également à encourager les Français à s’engager de manière régulière afin d’augmenter le nombre moyen de don par donneur, tout en facilitant l’accès aux collectes grâce à des dispositifs mobiles permettant ainsi de desservir des zones géographiques éloignées et d’atteindre des donneurs potentiels. De plus, une part importante des donneurs de sang est vieillissante (13% ont plus de 60 ans), ce qui souligne l’importance de toujours plus renouveler et diversifier le public donneur.
Les groupes sanguins et leur compatibilité
Une question essentielle pour la sécurité du receveur est la compatibilité de son groupe sanguin avec celui du donneur. Les groupes sanguins sont classés en fonction de la présence ou l’absence de certains antigènes sur les globules rouges : A, B, AB et O. Le facteur Rhésus, qu’il soit positif ou négatif, vient compléter ce système de classement car il peut, lui aussi, affecter la compatibilité et donc la sécurité de la transfusion. En France, les groupes sanguins les plus courant sont les groupes A et O tandis que le groupe AB est plus rare. Les groupes O- sont particulièrement rares mais très précieux car ils peuvent être donnés à n’importe quel patient, ce qui en fait des « donneurs universels ». À l'inverse le groupe AB+ est celui des « receveurs universels » : ils peuvent recevoir du sang de tous les groupes sanguins, mais ne peuvent en donner qu'aux personnes AB+.Une erreur de compatibilité peut entraîner des réactions graves, voire fatales. Par exemple, une personne de groupe sanguin A peut recevoir du sang de groupe A ou O mais pas du groupe B sous peine de provoquer une réaction hémolytique.
Les dangers de la transfusion sanguine
Bien que la transfusion sanguine soit un acte médical courant et sécurisé, elle comporte des risques, même si ceux-ci sont rares grâce aux procédures de sélection, de préparation et de dépistage. En 2023, 17 transfusions sanguines sur 100.000 présentaient des effets indésirables pour le receveur en France.Des complications très graves peuvent survenir lorsqu’un patient rejette les cellules sanguines transfusées ou si les deux sangs ne sont pas compatibles, entraînant une possible défaillance organique. Un autre risque, bien que minimisé, reste la transmission de maladies infectieuses. Si les techniques modernes de dépistage ont grandement réduit ce danger, il existe encore un risque infime de transmission de virus comme l’hépatite B, l’hépatite C, le VIH ou la syphilis.